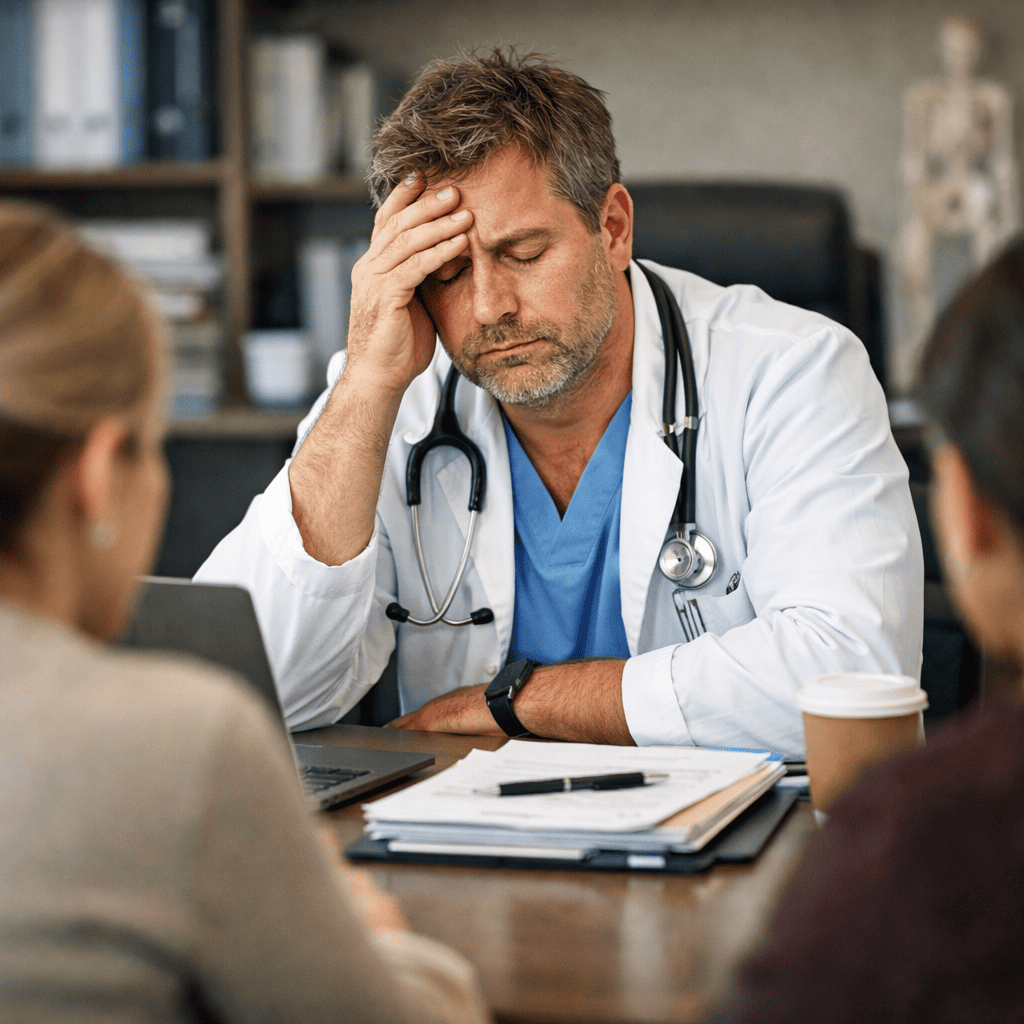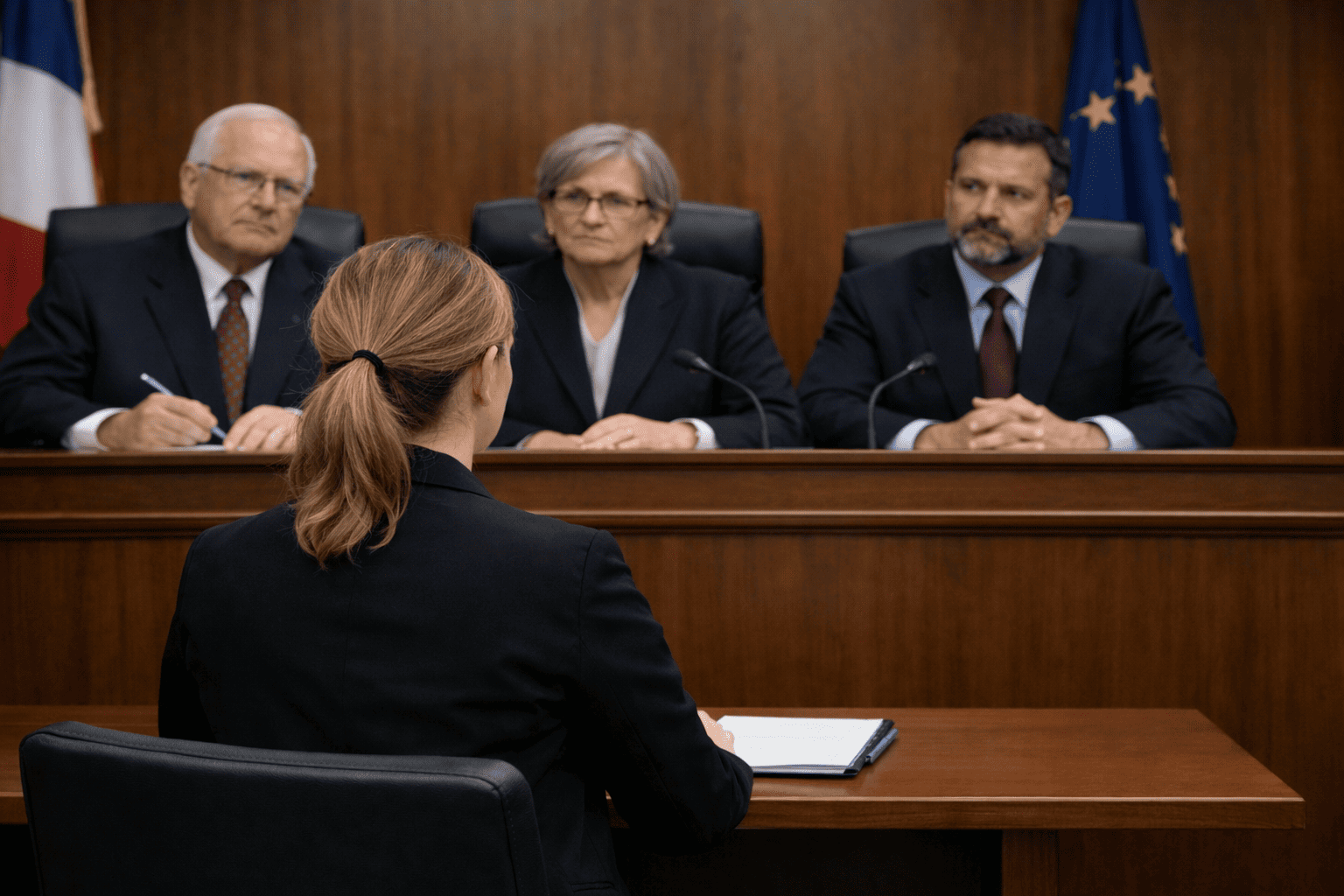Face à une notification d’indu imprécise, comment obtenir la production des tableaux d’indu pour votre défense ?
L’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 2025 illustre parfaitement l’importance de la production des pièces justificatives par la CPAM dans le cadre de la notification d’un indu à un professionnel de santé. L’affaire met en lumière les failles procédurales qui peuvent entacher une procédure de recouvrement d’indu et offre des perspectives encourageantes pour les professionnels de santé.
🔷 Faits : une procédure d’indu complexe contre une infirmière libérale
L’affaire trouve son origine dans un signalement adressé à la CPAM des Alpes-Maritimes concernant des soins prétendument facturés mais non exécutés. Suite à ce signalement, la caisse a engagé une enquête portant sur l’activité d’une infirmière libérale sur la période du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2012.
Le déroulement de la procédure administrative
La procédure administrative s’est déroulée en plusieurs étapes cruciales. Par courrier du 3 novembre 2014, la CPAM a notifié à l’infirmière un indu d’un montant considérable de 67 875,86 euros pour des anomalies de facturation présumées. Cette notification constituait le point de départ d’une longue bataille juridique qui allait s’étendre sur plusieurs années.
La situation s’est considérablement aggravée lorsque, par courrier du 26 décembre 2016, le directeur de la caisse lui a notifié une pénalité financière supplémentaire de 33 900 euros. Le montant total d’élève alors à plus de 100 000 euros, somme susceptible de compromettre gravement la poursuite de l’activité professionnelle de l’infirmière.
Les recours exercés par l’infirmière
Face à ces accusations qu’elle contestait fermement, l’infirmière a exercé tous les recours à sa disposition dans le respect des délais légaux. Elle a d’abord saisi la commission de recours amiable, espérant obtenir une révision favorable de la décision de la CPAM. Devant le rejet de ses demandes par la commission de recours amiable, elle s’est tournée vers le tribunal des affaires de sécurité sociale par plusieurs courriers recommandés échelonnés entre avril 2015 et janvier 2017 (aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire).
La décision de première instance
Le tribunal judiciaire de Nice a rendu son jugement le 10 février 2021.
Le tribunal a confirmé un indu de 52 308,53 euros, soit une réduction de plus de 15 000 euros par rapport à la réclamation initiale, et une pénalité financière considérablement réduite à 7 000 euros au lieu des 33 900 euros initialement réclamés.
Insatisfaite de cette décision qui maintenait un indu important et une pénalité financière, l’infirmière a interjeté appel le 9 mars 2021, ouvrant ainsi une nouvelle phase procédurale devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
🔷 Droit applicable : les exigences procédurales dans les contentieux d’indu
Les obligations de production de pièces par la CPAM
Dans les contentieux opposant les professionnels de santé aux organismes d’assurance maladie, le respect du contradictoire constitue un principe fondamental du droit processuel français. La CPAM doit apporter la preuve des faits qu’elle allègue et produire l’ensemble des pièces justificatives permettant au professionnel de santé d’exercer efficacement ses droits de la défense.
Cette obligation revêt une importance particulière s’agissant des tableaux récapitulatifs d’indu. Ces documents, qui détaillent l’identification des patients concernés, les dates de prescription, les noms des médecins prescripteurs, les dates des soins, la cotation des actes et les montants en cause, constituent la base même de l’accusation portée contre le professionnel de santé.
L’absence ou l’insuffisance de ces justificatifs peut conduire à l’annulation pure et simple de la procédure d’indu, protégeant ainsi les professionnels de santé contre des accusations non étayées.
Le principe du contradictoire et la réouverture des débats
Le principe u contradictoire implique que toutes les pièces sur lesquelles s’appuie une partie doivent être communiquées à l’adversaire dans des délais suffisants pour permettre une contradiction effective. Lorsque des pièces essentielles font défaut ou s’avèrent inexploitables, les juridictions disposent du pouvoir d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de produire les documents nécessaires à la manifestation de la vérité.
Cette prérogative juridictionnelle constitue un instrument puissant de protection des droits de la défense et permet d’éviter que des décisions soient rendues sur la base d’éléments incomplets.
La charge de la preuve dans les contentieux d’indu
En matière de recouvrement d’indu, la CPAM supporte la charge de prouver la réalité des irrégularités qu’elle invoque. Cette charge probatoire découle du principe général selon lequel celui qui allègue un fait doit le prouver. Dans le contexte spécifique des indus de sécurité sociale, cette exigence revêt une importance cruciale car elle protège les professionnels de santé contre des accusations infondées.
Cette preuve doit être rapportée par la production de pièces précises, lisibles et exploitables, permettant d’établir un lien direct entre les actes facturés et les prétendues anomalies. La simple allégation d’irrégularités ne saurait suffire ; la CPAM doit démontrer concrètement, acte par acte, patient par patient, en quoi la facturation serait irrégulière.
Cette exigence de précision dans la preuve constitue une garantie fondamentale pour les professionnels de santé, qui peuvent ainsi contester point par point les reproches qui leur sont adressés et démontrer la régularité de leur pratique.
🔷Solution retenue : une injonction salutaire pour les droits de la défense
L’analyse critique des pièces produites par la CPAM
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a procédé à un examen minutieux des pièces versées aux débats par la CPAM, révélant plusieurs défaillances majeures dans la constitution du dossier de l’organisme d’assurance maladie. Cette analyse critique démontre l’importance d’un contrôle juridictionnel rigoureux des éléments produits par les parties.
Premièrement, les magistrats ont constaté que les tableaux récapitulatifs décrits par les premiers juges et censés être annexés à la notification de griefs n’avaient pas été versés aux débats d’appel:
« Les premiers juges ont indiqué que la CPAM avait produit «des tableaux récapitulant l’identification des patients concernés, les dates de prescription, le nom du médecin prescripteur, les dates des soins, la cotation des actes, le montant remboursé, le montant du préjudice, représentant les actes irrégulièrement facturés, la date de mandatement du paiement indu, les tableaux regroupant les actes par motif d’indu ». Ils mentionnent également un certain nombre de prescriptions médicales versées aux débats.
Or, si le bordereau de communication de pièces de la caisse mentionne la production de la pièce n°4 ( notification de griefs+ tableaux récapitulatifs annexés+LRAR du 25 août 2014) , force est de constater que ne sont pas versés les tableaux tels que décrits par les premiers juges et censés être annexés à la notification de griefs. Le seul le tableau annexé est intitulé : ‘ préjudice final- étude faite sur la période du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2012/ préjudice potentiel- étude faite sur la période du 1er septembre 2011 au 27 novembre 2012″ et ne peut donc correspondre à ce qui est évoqué dans le jugement de première instance « .
Deuxièmement, la Cour a relevé une confusion particulièrement préoccupante dans les pièces produites : l’étude du service contrôle concernait en réalité l’activité d’une autre infirmière et non celle de la défenderesse.
Troisièmement, contrairement aux affirmations du jugement de première instance, aucune prescription médicale n’avait été versée aux débats d’appel par la CPAM, privant ainsi la juridiction d’éléments essentiels à l’appréciation du bien-fondé des reproches formulés.
L’inexploitabilité des pièces produites par l’appelante
La Cour a également examiné les pièces produites par l’infirmière, qui avait versé environ soixante ordonnances correspondant aux patients présumés figurer dans les tableaux de la CPAM. Cette démarche témoignait de la bonne foi de la professionnelle de santé et de sa volonté de démontrer la régularité de sa pratique.
Cependant, ces documents se sont révélés inexploitables en l’état, étant impossibles à rattacher aux codes de facturation et à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en raison de leur transmission en version « brute ». Cette situation illustre l’importance de la coordination entre les parties et de la production de pièces lisibles et exploitables, permettant une véritable contradiction sur le fond du dossier.
La décision d’injonction : une mesure d’instruction nécessaire
Face à ces carences procédurales majeures, la Cour d’appel a ordonné la réouverture des débats avec injonction faite à la CPAM des Alpes-Maritimes de produire les tableaux récapitulatifs versés aux débats en première instance et les prescriptions médicales lisiblement reliées aux indus supposés:
« Il ressort dès lors d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats avec injonction faite à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes de produire les tableaux récapitulatifs versés aux débats en première instance et les prescriptions médicales lisiblement reliées aux indus supposés. L’affaire est renvoyée à l’audience du 11 février 2026 à 9h00 les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées ».
Cette injonction CPAM revêt une portée considérable pour plusieurs raisons fondamentales. D’une part, elle rappelle fermement aux organismes d’assurance maladie leurs obligations procédurales et leur devoir de transparence dans la conduite des procédures de recouvrement d’indu.
D’autre part, elle garantit aux professionnels de santé la possibilité d’exercer pleinement leurs droits de la défense en ayant accès à l’ensemble des éléments sur lesquels se fonde l’accusation. Cette garantie procédurale constitue un rempart essentiel contre l’arbitraire administratif et assure l’équité des débats judiciaires.
Les perspectives pour la suite de la procédure
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 février 2026, offrant à la CPAM un délai suffisant pour régulariser sa situation procédurale. Cette décision de renvoi, loin de constituer un simple report, représente une véritable mise en demeure adressée à l’organisme d’assurance maladie.
Si la CPAM ne parvient pas à produire les pièces demandées ou si celles-ci s’avèrent insuffisantes, la Cour pourrait être amenée à annuler purement et simplement la procédure d’indu, libérant ainsi l’infirmière de toute obligation de remboursement et de pénalité financière. –
Cette décision illustre parfaitement l’importance de ne jamais accepter passivement une procédure d’indu et de contester systématiquement les carences procédurales des organismes d’assurance maladie.
💡Les enseignements pour la défense des professionnels de santé
Cette décision rappelle que la CPAM ne peut se contenter d’allégations générales mais doit apporter des preuves précises et exploitables.
Pour les infirmiers libéraux et l’ensemble des professionnels de santé, cette décision constitue un précédent encourageant, montrant que les juridictions sont attentives au respect des droits de la défense et n’hésitent pas à sanctionner les carences procédurales des organismes d’assurance maladie..
—
Référence de la décision : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 30 avril 2025, n° 23/04717
Sur le même sujet : Comment contester une notification d’indu de la CPAM ? Guide pratique