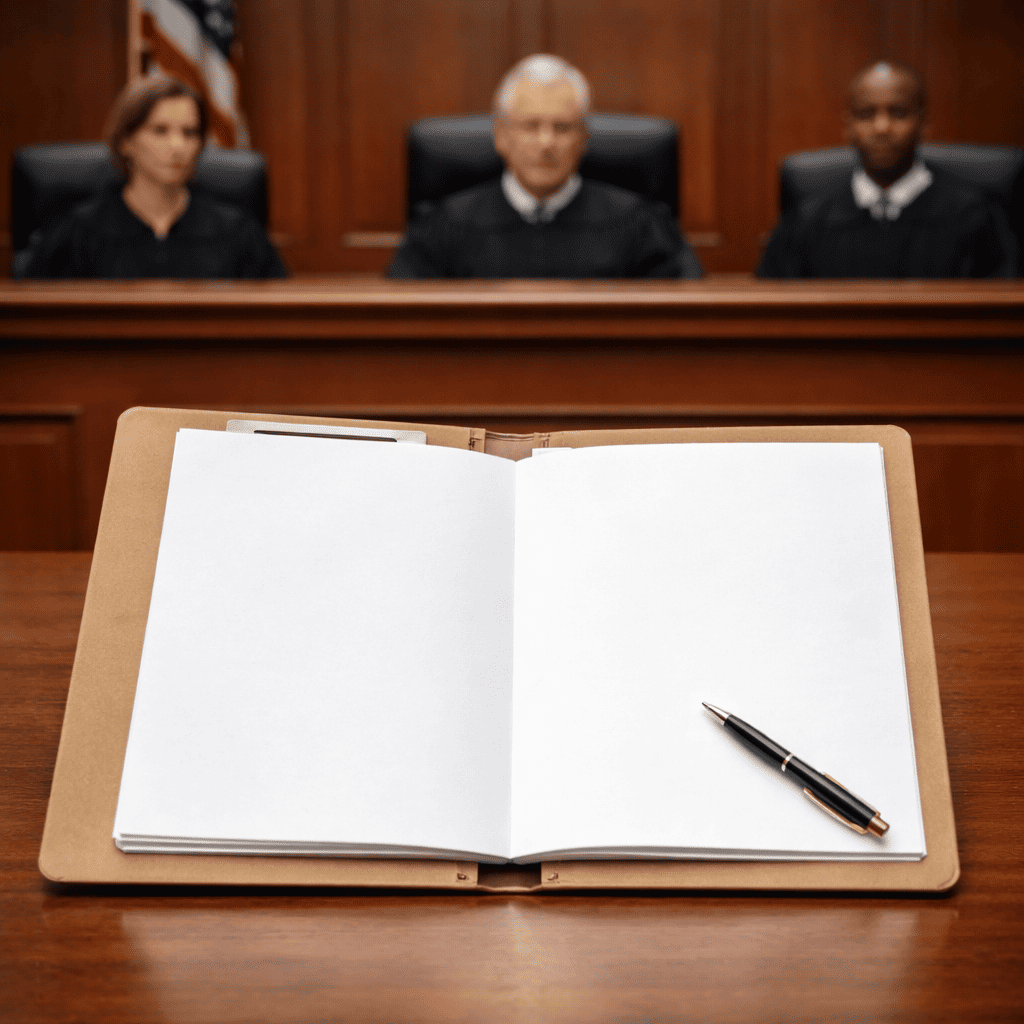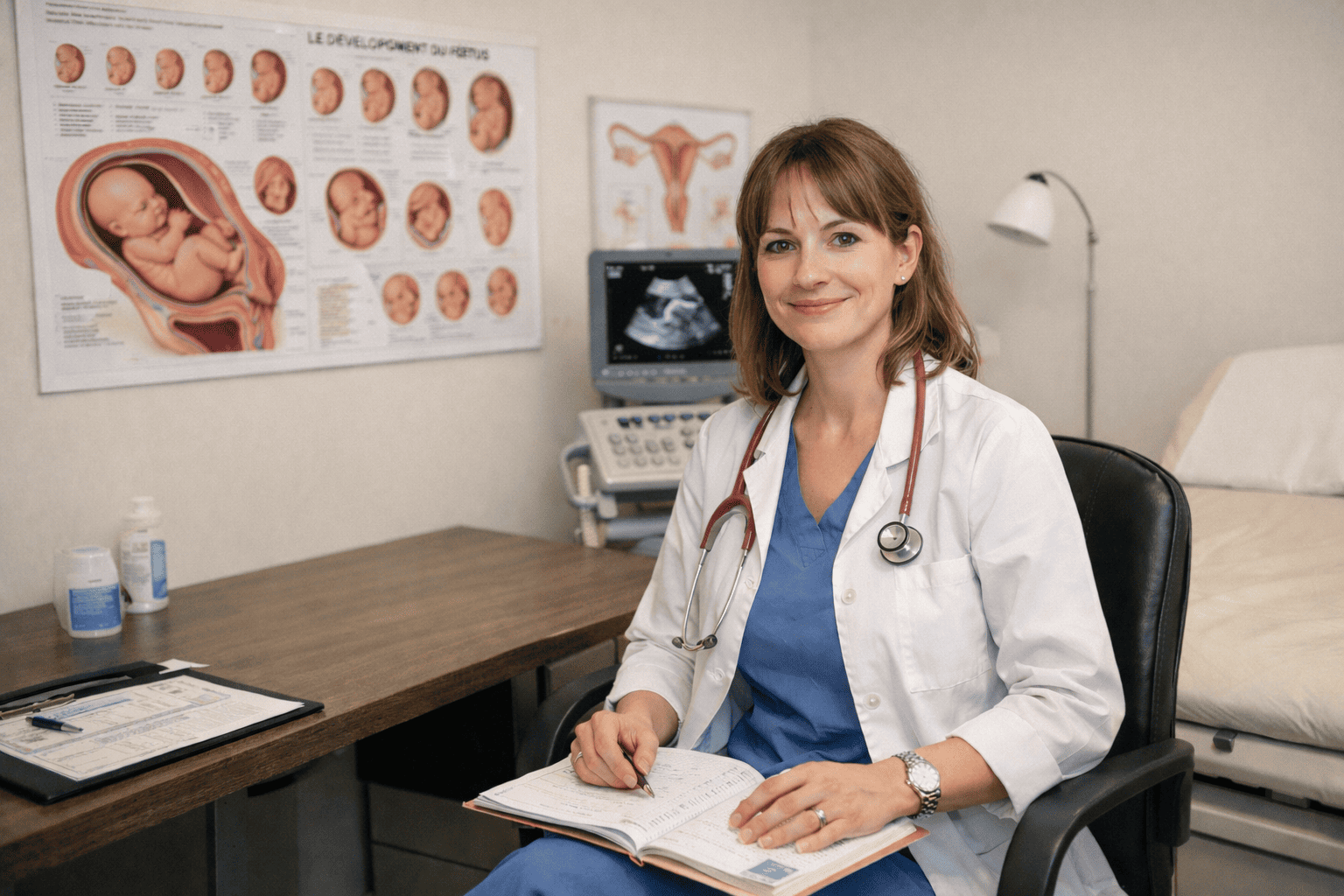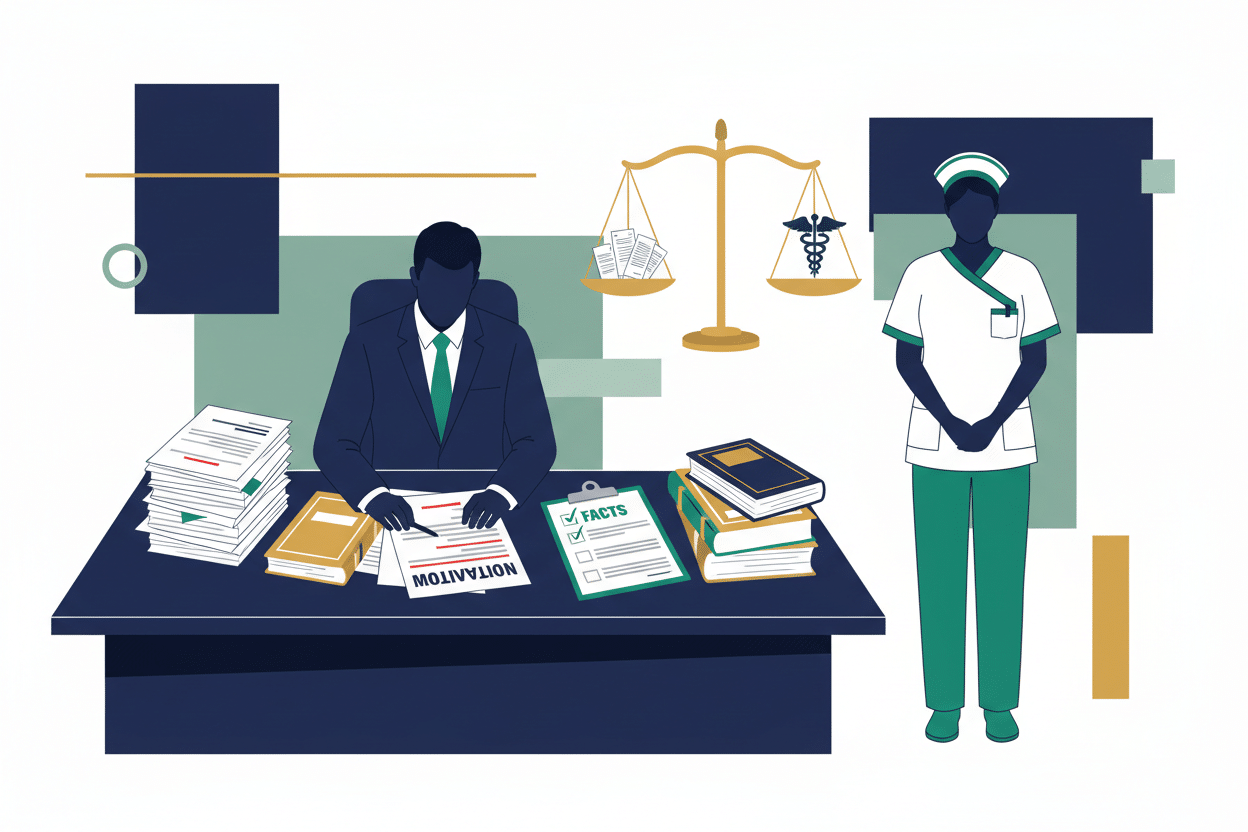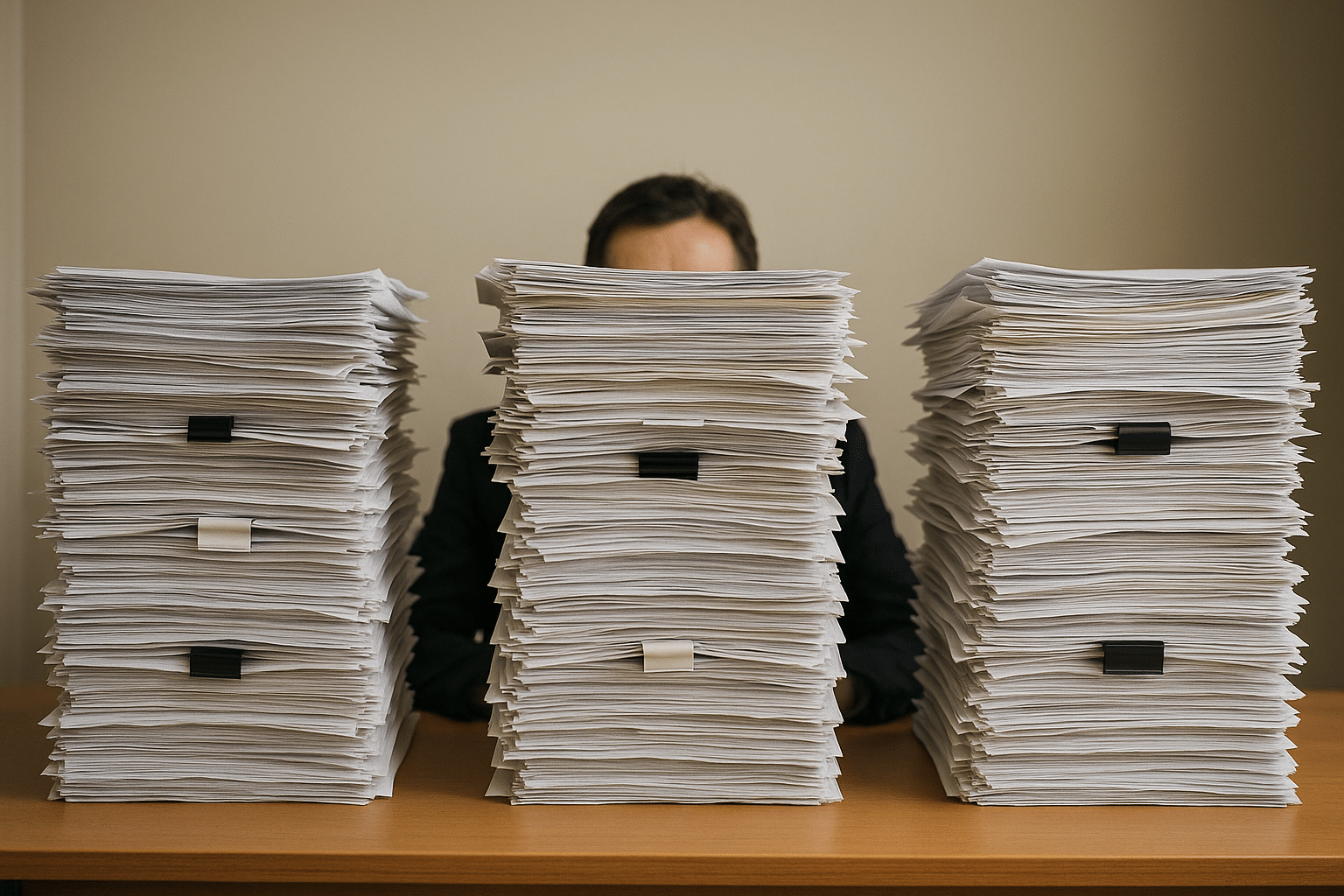
Le refus de communication de documents administratifs fait l’objet de nombreux contentieux.
Une récente décision du Conseil d’État illustre parfaitement les limites que rencontrent les administrations lorsqu’elles tentent d’opposer la charge de travail excessive pour refuser la communication de documents administratifs. Cette décision précise les contours de l’obligation de communication et les critères d’appréciation de la charge de travail excessive, offrant un éclairage essentiel pour tous les agents publics confrontés à de telles demandes.
🔷 Faits
L’origine de la demande de communication
L’affaire trouve son point de départ dans une démarche journalistique légitime menée par le rédacteur en chef du journal Médiacités. Ce professionnel des médias avait adressé au président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes une demande de communication de documents administratifs d’une ampleur considérable. Sa requête portait sur l’ensemble des justificatifs financiers relatifs aux frais engagés par les responsables régionaux : reçus, factures, notes de frais de séjour, frais de déplacement, de restauration, de représentation, de mission et d’exécution des mandats spéciaux.
Cette demande concernait non seulement le président de la région, mais également l’ensemble de son exécutif ainsi que les membres de son cabinet, sur une période de trois années consécutives, de 2019 à 2021. L’objectif journalistique était clair : exercer un contrôle démocratique sur l’utilisation des deniers publics par les élus et leurs collaborateurs.
La volumétrie exceptionnelle des documents concernés
Face à cette demande, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est rapidement trouvée confrontée à un défi logistique majeur. L’administration régionale a en effet identifié pas moins de 7 784 pièces comptables correspondant aux critères de la demande de communication de documents administratifs. Cette volumétrie exceptionnelle représentait un travail considérable de collecte, de tri et de traitement.
La complexité de la tâche était d’autant plus importante qu’aucun système de traitement automatisé ne permettait de rassembler rapidement ces documents. L’administration devait procéder manuellement à leur identification, leur extraction des archives, et surtout effectuer un important travail d’occultation pour protéger les informations relevant des exceptions légales à la communication.
Les engagements initiaux et le revirement de position
Face au refus initia de la région, la Commission d’accès aux documents administratifs avait émis à un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Paradoxalement, la région avait dans un premier temps accepté le principe de cette communication de documents administratifs. L’administration s’était même formellement engagée à transmettre l’ensemble des documents sollicités au cours du premier trimestre 2023. Cet engagement avait été renouvelé dans les premières écritures de défense de la collectivité, témoignant d’une volonté initiale de respecter les obligations de transparence.
Cependant, confrontée à l’ampleur concrète de la tâche, la région a progressivement modifié sa position. Face au silence persistant de l’administration malgré ses engagements, le journaliste a été contraint de saisir le tribunal administratif de Lyon pour contester cette décision implicite de refus. C’est alors que la région a développé une nouvelle argumentation, invoquant la charge de travail excessive que représentait cette communication pour justifier son refus.
La décision du tribunal administratif de Lyon
Le tribunal administratif de Lyon a tranché clairement en faveur du demandeur, annulant la décision implicite de rejet de la région et lui enjoignant de procéder à la communication des documents administratifs sollicités. Cette décision s’appuyait sur la jurisprudence constante reconnaissant la communicabilité des documents relatifs aux frais des élus locaux et agents publics.
Insatisfaite de cette décision, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État, estimant que le tribunal avait méconnu les règles applicables en matière de charge de travail excessive et d’occultation des informations protégées.
🔷Droit applicable: un équilibre entre transparence et contraintes pratiques
Le cadre juridique fondamental de la communication
Le droit d’accès aux documents administratifs trouve son fondement principal dans le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui organise de manière exhaustive les modalités de cette communication. La jurisprudence du Conseil d’État a établi des principes clairs et constants concernant la communicabilité des notes de frais et reçus de déplacements des élus locaux et agents publics.
Ces documents sont systématiquement considérés comme des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par le CRPA. Cette position jurisprudentielle repose sur le principe selon lequel l’utilisation des deniers publics doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle démocratique, particulièrement lorsqu’il s’agit des frais engagés par les responsables politiques et leurs collaborateurs.
Les exceptions légales à la communication
Toutefois, cette obligation de communication de documents administratifs n’est pas absolue. Les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA prévoient des exceptions destinées à protéger certains secrets et intérêts légitimes. Ces dispositions permettent à l’administration de refuser la communication ou d’occulter certaines informations lorsque leur divulgation serait susceptible de porter atteinte à des intérêts protégés.
La jurisprudence Ville de Paris du 8 février 2023 a précisé les modalités d’application de ces exceptions. L’autorité administrative doit procéder à une appréciation au cas par cas, en examinant si, eu égard aux circonstances particulières tenant au contexte de l’événement auquel un document se rapporte, la communication de certaines informations serait de nature à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés.
La reconnaissance jurisprudentielle de la charge de travail excessive
La notion de charge de travail excessive constitue un motif de refus reconnu par la jurisprudence administrative, mais sous des conditions strictement encadrées.
L’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2018, Ministre de la culture, et celui du 17 mars 2022, M. F…, ont établi les critères d’appréciation de cette notion.
Cette jurisprudence impose une mise en balance entre la charge de travail que représente la communication et l’intérêt qui s’attache aux documents demandés. L’administration ne peut donc pas invoquer de manière systématique cet argument, mais doit démontrer que la charge est réellement excessive au regard des moyens dont elle dispose et de l’intérêt de la demande.
Le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
Les juridictions administratives disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation en matière de charge de travail excessive. Cette prérogative leur permet d’évaluer concrètement les circonstances de chaque espèce, en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier : volume des documents, moyens de l’administration, intérêt de la demande, qualité du demandeur.
Cette appréciation souveraine constitue une garantie importante pour les demandeurs, car elle permet aux juges d’adapter leur décision aux spécificités de chaque situation, sans être liés par des critères rigides qui pourraient faire obstacle au droit d’accès aux documents administratifs.
🔷 Solution retenue: la primauté de l’intérêt public sur les contraintes administratives
L’analyse du rapporteur public
Le rapporteur public M. Frédéric Puigserver a recommandé le rejet de la requête de la région, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas la cassation du jugement du tribunal administratif. Son analyse détaillée a mis en évidence plusieurs éléments déterminants pour l’appréciation de cette affaire.
Bien que reconnaissant que les circonstances étaient proches de celles ayant justifié l’admission d’une charge de travail excessive , le rapporteur public a souligné l’intérêt particulier qui s’attachait à cette demande de communication de documents administratifs. Il a notamment relevé que la demande émanait d’un média professionnel dont le travail était reconnu comme sérieux, dans le cadre d’une mission d’information du public d’intérêt général.
Le rejet des moyens de cassation développés par la région
Le Conseil d’Etat rappelle que :
« Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent ».
Concernant le premier moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier, le Conseil d’État a confirmé que l’appréciation souveraine des juges du fond devait être respectée. L’argument de la charge de travail excessive, bien que recevable en principe, ne pouvait prévaloir face à l’intérêt légitime de la demande de communication.
Le rapporteur public a particulièrement insisté sur la contradiction dans la position de la région, qui s’était initialement engagée à communiquer les documents avant d’invoquer tardivement la charge de travail excessive. Cette incohérence a pesé dans l’appréciation de la juridiction et a démontré que l’argument était davantage de circonstance que fondé sur une réelle impossibilité pratique.
Le second moyen, relatif à l’insuffisance de motivation concernant le manque de précision de la demande, a été écarté au motif qu’il s’agissait plutôt d’un argument développé au soutien du moyen principal, sans constituer un grief autonome susceptible de justifier la cassation.
La question cruciale des occultations nécessaires
Le troisième moyen soulevait une question juridique importante : le tribunal avait-il méconnu l’obligation de réserver les cas où la communication serait de nature à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA ?
Le rapporteur public a adopté une interprétation bienveillante et pragmatique du jugement du tribunal administratif. Il a considéré que l’annulation de la décision de refus et l’injonction de communication prononcées devaient s’interpréter comme réservant implicitement mais nécessairement le cas des informations à occulter par l’administration au titre des dispositions protectrices du code.
Cette solution équilibrée permet de concilier efficacement le droit à l’information avec les impératifs de protection des données sensibles, sans imposer aux juridictions de détailler exhaustivement toutes les exceptions possibles dans leurs décisions.
Les implications pratiques pour les fonctionnaires et les administrations
Cette décision établit des principes directeurs clairs pour les fonctionnaires et agents publics chargés de traiter les demandes de communication de documents administratifs. Elle rappelle que la charge de travail excessive ne peut être invoquée de manière systématique et doit être appréciée au regard de l’intérêt public de la demande.
Les administrations doivent désormais organiser leurs services de manière à pouvoir répondre aux demandes légitimes de communication, même lorsque celles-ci portent sur un volume important de documents. Cette obligation implique une réflexion sur les systèmes d’archivage, de classement et de traitement des documents, ainsi que sur l’allocation des moyens humains nécessaires.
La décision renforce également l’obligation de transparence des collectivités publiques, particulièrement en matière de gestion des deniers publics. Elle encourage une approche proactive de la transparence administrative, privilégiant la communication spontanée plutôt que la résistance contentieuse.
***
Référence de la décision : Conseil d’Etat, 23 juillet 2025, 495393
Sur le même sujet : Occultation des documents administratifs après une demande de communication