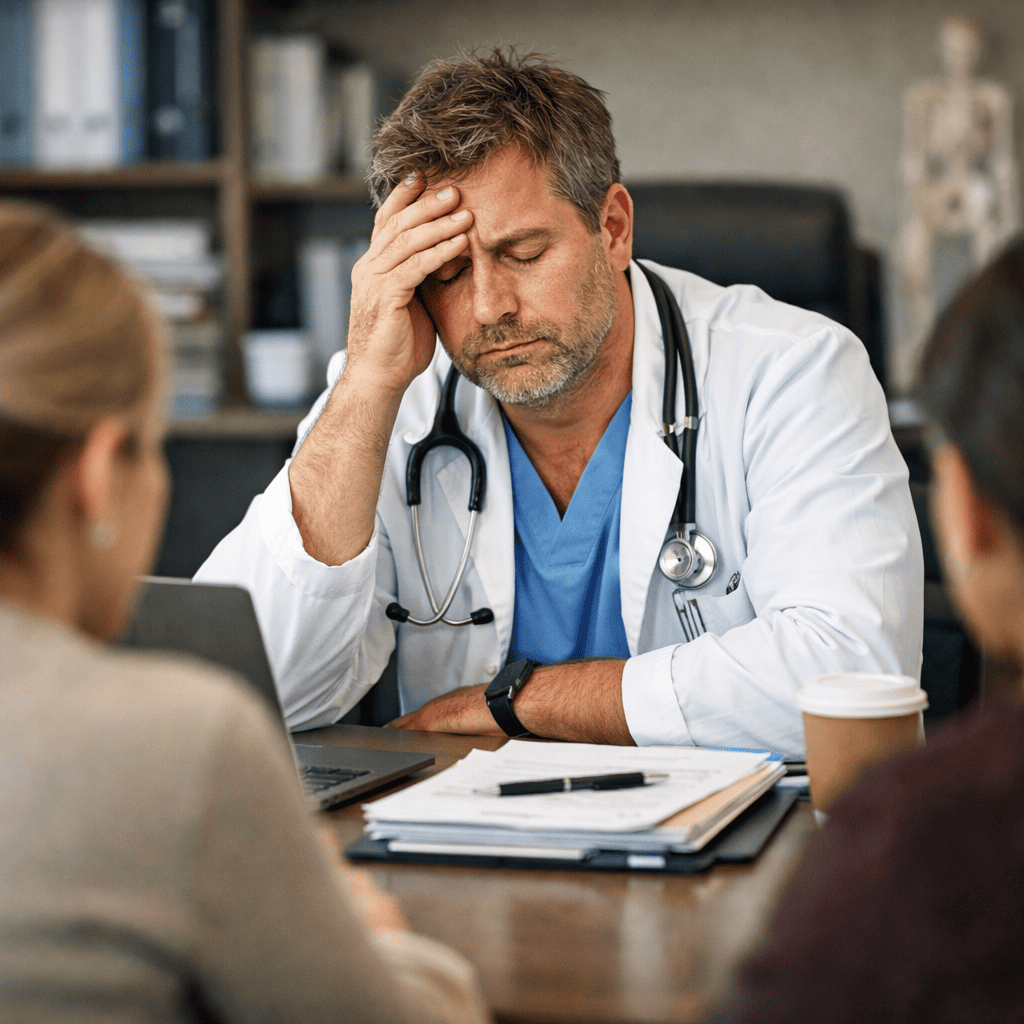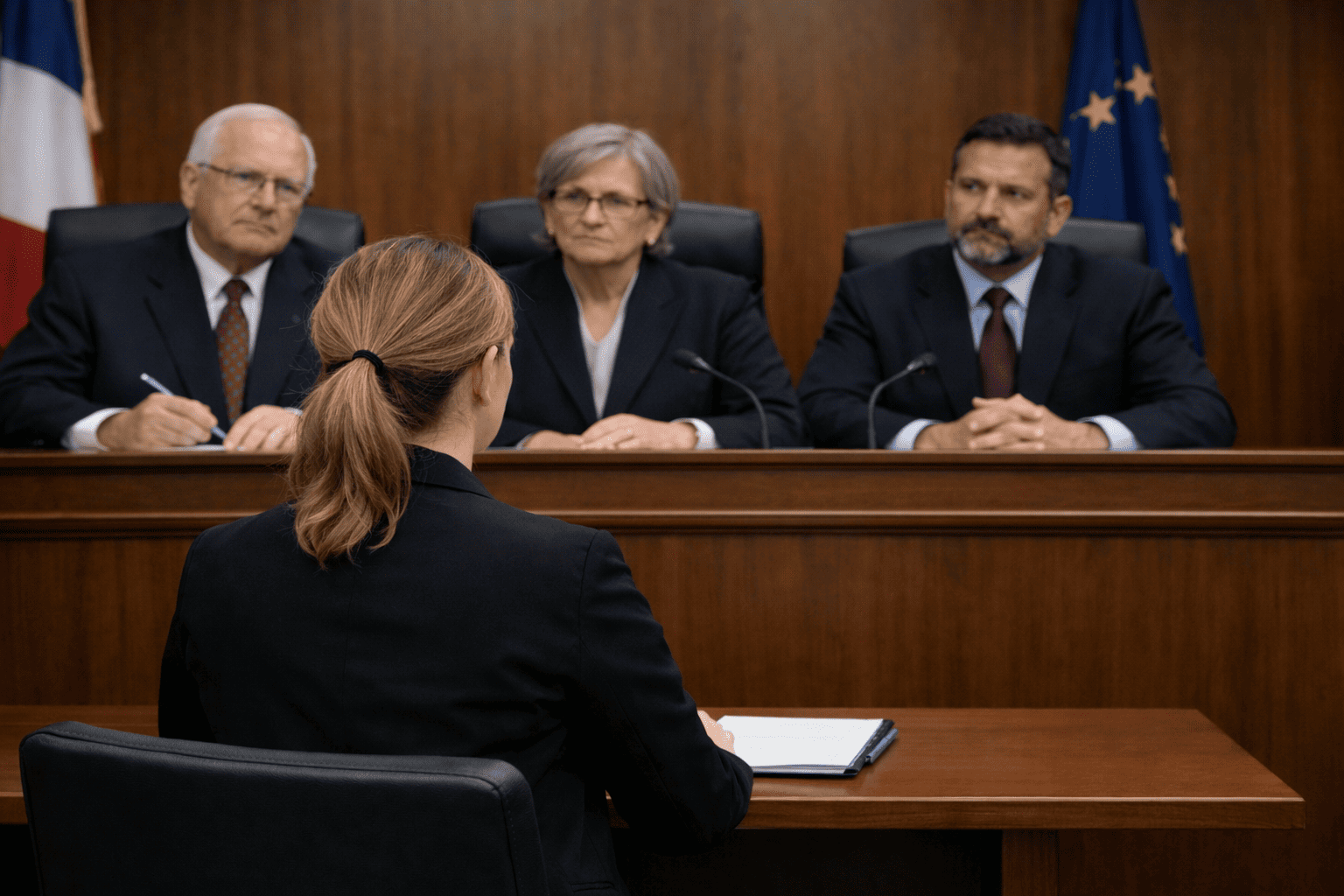La reconnaissance d’un accident de service dans la fonction publique obéit à un régime juridique précis, articulé autour de la notion d’imputabilité au service, de la définition stricte de l’accident et de l’exclusion de certaines circonstances. Les articles L822-18 et L822-19 du code général de la fonction publique, posent une présomption d’imputabilité au service pour tout accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l’accident du service.
La jurisprudence administrative a précisé la portée de ces critères, notamment quant à la nature de l’événement, la notion de lésion, la preuve du lien avec le service et les cas d’exclusion.
L’analyse qui suit expose, d’abord, le cadre légal et la définition de l’accident de service, puis les critères jurisprudentiels d’imputabilité, avant d’aborder les exclusions et les cas particuliers, notamment l’accident de trajet.
🔷 Droit applicable
Le cadre légal et la définition de l’accident de service
L’article L822-18 du code général de la fonction publique dispose que:
« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Cette présomption d’imputabilité au service constitue le socle du régime protecteur applicable aux fonctionnaires victimes d’un accident survenu dans le cadre de leur activité professionnelle ».
La jurisprudence administrative a précisé la notion d’accident de service. Il s’agit:
- d’un événement soudain et violent,
- survenu à une date certaine,
- par le fait ou à l’occasion du service,
- dont il est résulté une lésion médicalement constatée.
La date d’apparition de la lésion n’est pas déterminante :
« constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » Conseil d’État, Chambres réunies, 18 juillet 2025, 476311.
➡️ Dans cet arrêt, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles pour avoir exigé un lien direct, certain et déterminant entre l’infarctus survenu en service et l’exécution des fonctions, alors que l’accident survenu dans le temps et lieu du service est présumé imputable au service sauf preuve que l’état antérieur est la cause exclusive. Il rappelle ainsi le principe de la présomption d’imputabilité au service des accidents survenus dans l’exercice des fonctions, sauf faute personnelle ou circonstance particulière.
Les critères d’imputabilité au service de l’accident
La présomption d’imputabilité et ses conditions
La présomption d’imputabilité au service s’applique dès lors que l’accident survient dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou d’une activité en constituant le prolongement normal. Cette présomption ne peut être écartée qu’en cas de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l’accident du service.
L’exclusion par la faute personnelle ou la circonstance particulière
La présomption d’imputabilité est écartée en cas de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l’accident du service. La faute personnelle suppose un comportement de l’agent étranger au service, tandis que la circonstance particulière vise tout élément de fait ou de droit qui rompt le lien avec le service.
L’état de santé antérieur ne constitue une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident:
« Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident,(…) est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident » (Conseil d’État, Chambres réunies, 18 juillet 2025, 476311.)
La présomption d’imputabilité peut toutefois être écartée dans certaines circonstances.
La faute personnelle de l’agent constitue la première exception. A titre d’exemple, le Conseil d’État a ainsi jugé que le choix délibéré de conduire sous l’emprise de l’alcool après un repas de service constituait un fait personnel détachable du service, excluant la reconnaissance de l’accident (Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 03/11/2023, 459023).
De même, l’existence de circonstances particulières étrangères au service peut faire obstacle à la reconnaissance : un malaise survenu à domicile après la fin du service n’a pas été considéré comme un accident de trajet (CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 22NC01181).
L’accident de trajet
L’article L822-19 du code général de la fonction publique dispose que:
« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service ».
➡️ l’accident de trajet est reconnu dès lors qu’il survient sur le parcours habituel, pendant la durée normale, et qu’aucune circonstance particulière ne vient détacher l’accident du service:
« Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a relevé que l’accident dont M. B… a été victime s’est produit alors que l’agent avait quitté son appartement situé dans un immeuble d’habitation collectif pour se rendre à son lieu de travail. En jugeant que, dans ces conditions, M. B… devait être regardé comme ayant commencé le trajet le conduisant vers son lieu de travail et que l’accident subi par cet agent public revêtait ainsi le caractère d’un accident de trajet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet accident s’est produit à l’intérieur d’un garage collectif situé dans l’enceinte de l’ensemble résidentiel dans lequel se trouvait son appartement, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ». (Conseil d’État, Chambres réunies, 27 juin 2025, 494081.)
🔷Droits et indemnisation
En cas de reconnaissance de l’imputabilité au service, le fonctionnaire bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), instauré par les décrets de 2019, qui garantit le maintien intégral du traitement pendant toute la période d’arrêt de travail.
En application de l’article Article L822-24 du CGFP, l’agent bénéficie également de la prise en charge des frais médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la maladie.
En cas d’invalidité permanente, une allocation temporaire d’invalidité (ATI) peut être accordée.
La jurisprudence a également ouvert la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire pour les préjudices à caractère personnel et patrimoniaux non couverts par la rente d’invalidité, même en l’absence de faute de l’employeur
🔷 Quelle différence avec la maladie professionnelle ?
La différence fondamentale entre ces deux régimes réside dans la nature de l’événement à l’origine de l’atteinte à la santé. L’accident de service se caractérise par la survenance d’un fait précis, daté, survenu de manière soudaine.
À l’inverse, la maladie professionnelle résulte d’une exposition prolongée ou répétée à un risque professionnel, ou d’une intoxication lente, et ne découle pas d’un événement unique et soudain. Elle se caractérise par l’apparition progressive d’une pathologie, contrairement à l’accident de service où les symptômes apparaissent immédiatement ou très rapidement.
L’article L822-20 du Code général de la fonction publique dispose que:
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. La reconnaissance d’une maladie professionnelle suppose donc, en principe, l’inscription de la pathologie dans un tableau réglementaire, la réalisation des conditions de ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, nature des travaux) et le lien avec l’activité professionnelle. À défaut, la maladie peut être reconnue imputable au service si le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions ».
En conclusion, la reconnaissance des accidents de service dans la fonction publique demeure un mécanisme de protection essentiel qui, malgré sa complexité procédurale, garantit aux agents publics une présomption d’imputabilité favorable.
****
Sur le même sujet :Imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif