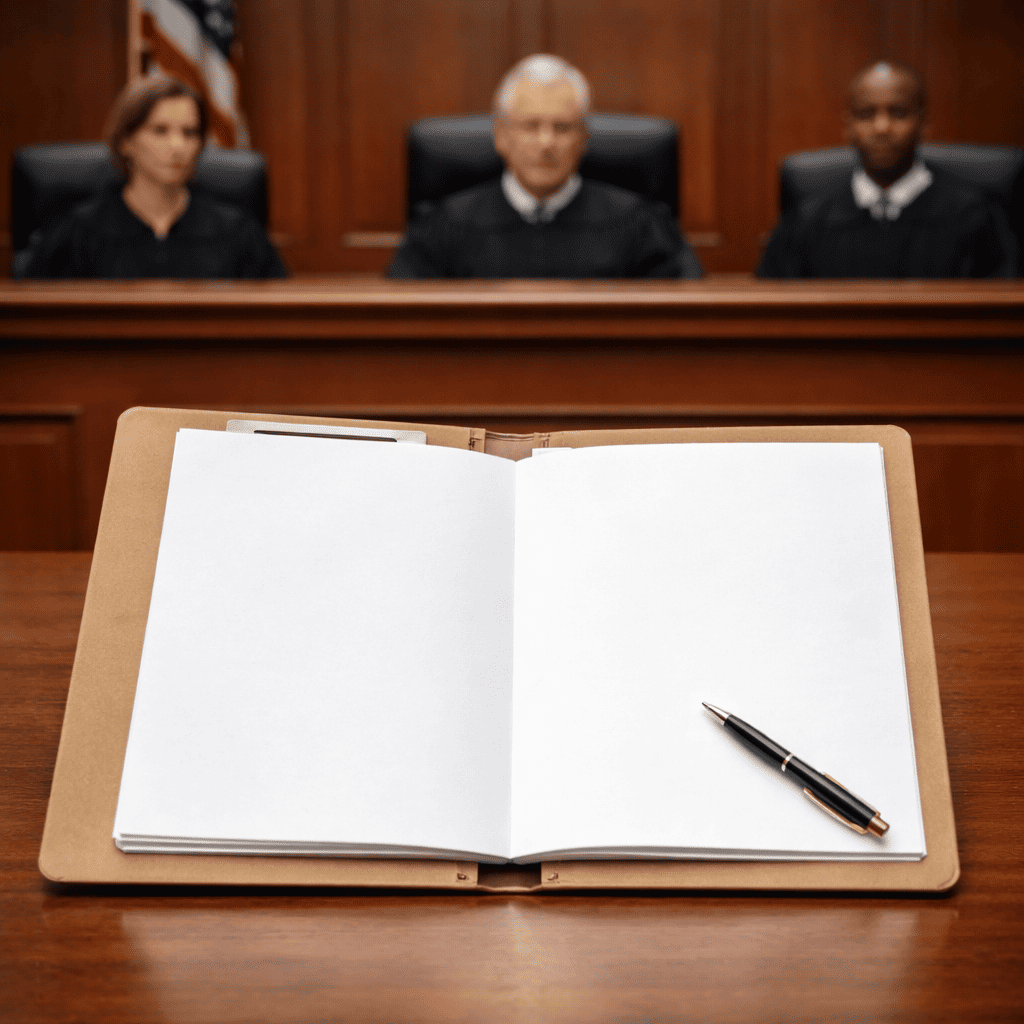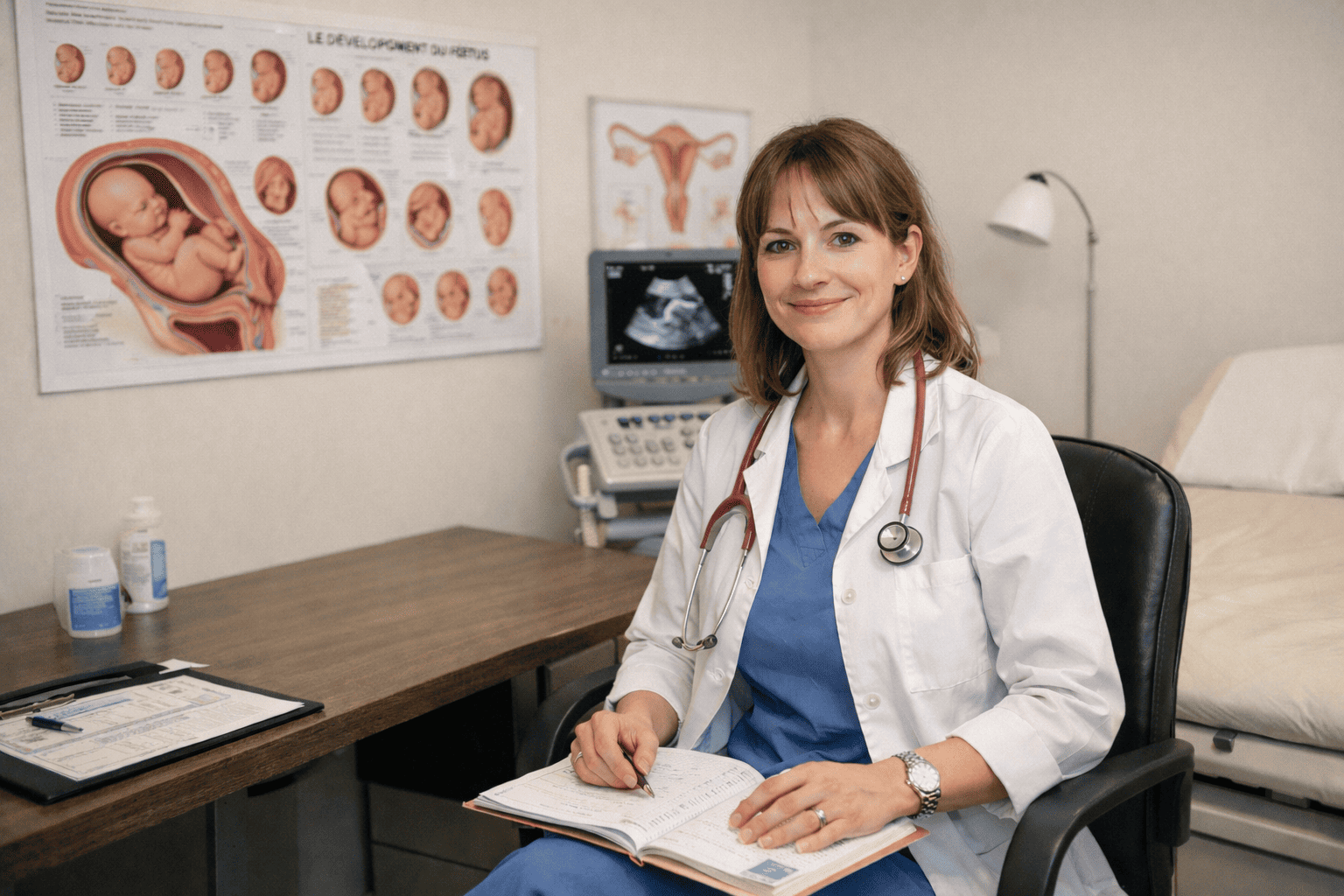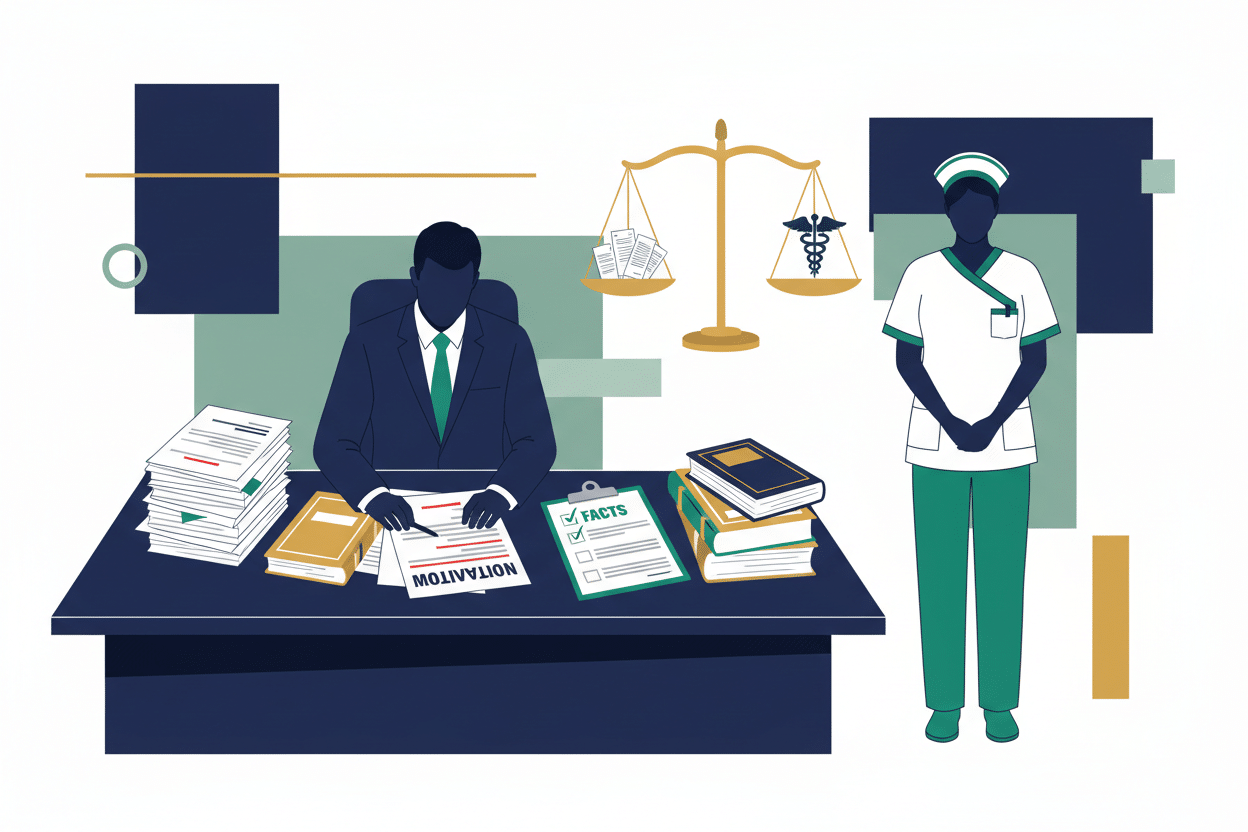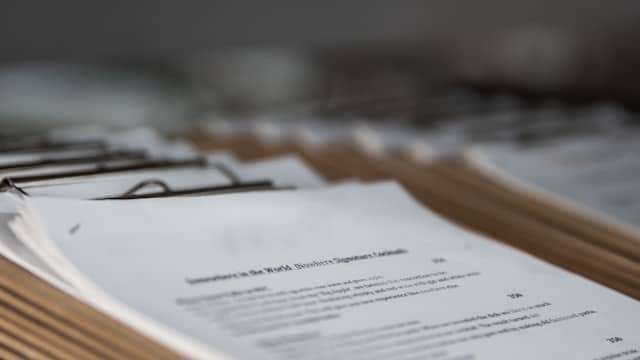
Le Conseil d’État vient préciser ce que constitue une demande abusive en matière de communication de documents administratifs.
🔷 Faits
À la fin de l’année 2022, le Syndicat de la magistrature a sollicité la communication d’une centaine de rapports de l’Inspection générale de la justice (IGJ), rédigés entre 2018 et 2021.
La Première ministre et le garde des Sceaux ont opposé un refus implicite, malgré un avis favorable de la CADA sous réserve d’occultations.
Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé ces refus pour 81 rapports et a ordonné leur communication après occultation. Le ministre a formé un pourvoi.
Par sa décision du 28 octobre 2025, le Conseil d’État a rejeté ce pourvoi et confirmé l’injonction.
🔷 Droit applicable
Qu’est-ce qu’un document administratif communicable ?
Réponse à l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.
Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
L’article L311-5 du CRPA prévoit une liste des documents non communicables.
➡️ Les rapports de l’IGJ constituent des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 300-2 du CRPA.
Dans quelles cas l’administration doit occulter les mentions non communicables ?
Réponses à l’article L. 311-7 du CRPA :
« Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
L’administration peut elle refuser de communiquer les documents administratifs si elle estime que la demande est abusive ?
Oui. Le dernier alinéa de l’article L. 311-2 du CRPA autorise l’administration à ne pas donner suite aux « demandes abusives »:
« L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Le rapporteur public sous la décision commentée, M. Frédéric PUIGSERVER, rappelle que la « demande abusive » recouvre deux hypothèses distinctes.
1/ Les démarches destinées à perturber le fonctionnement de l’administration. il s’agit des demandes qui » sont adressées, de façon répétée, par le même demandeur à la même administration ou qu’il est notoire que le demandeur détient déjà les documents demandés ou ne peut ignorer leur inexistence.
2/ Les demandes qui, si elles étaient satisfaites, imposeraient une charge de travail disproportionnée au regard des moyens de l’administration (CE 14 nov. 2018, Ministre de la culture c. Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, n° 420055 et autre)
Comment est apprécié le caractère abusif d’une demande ?
Le Conseil d’Etat a précisé les critères d’appréciation :
« la personne qui demande la communication de documents administratifs n’a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ou sur celles de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En revanche, lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public » Conseil d’État, Chambres réunies, 17 mars 2022, 449620
🔷 Solution retenue
Dans cette affaire, la question de droit qui se posait était la suivante :
Le refus de communication des rapports de l’inspection générale de la justice par l’administration peut-il être justifié par une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose ?
Le Conseil d’État écarte d’abord le moyen tiré de l’erreur de droit.
➡️ Le tribunal administratif n’était pas tenu de se faire communiquer les 81 rapports pour apprécier la charge que représenteraient les occultations. Il lui appartenait de statuer au vu des éléments fournis par les parties, l’exigence de production des documents n’étant qu’une faculté, non une obligation, lorsque le débat porte sur la charge de travail :
« Lorsque l’administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu’elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, de telle sorte que la demande de communication présente le caractère d’une demande abusive ainsi qu’il a été dit au point 3, il lui appartient d’apporter tous éléments de nature à établir la réalité de ce qu’elle avance. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il a alors la faculté d’exiger de l’administration compétente la production de tout élément susceptible de permettre de vérifier le bien-fondé de ce qu’elle avance, et, en particulier, s’agissant d’un litige dont l’objet même est le refus de communication des documents demandés, la communication de ceux-ci, en totalité ou en partie, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n’ait le droit d’en prendre connaissance au cours de l’instance, il ne méconnaît pas son office en s’abstenant de le faire alors que le débat porte sur la charge de travail que les occultations ou disjonctions représentent« .
Au total, 81 rapports ont été demandés pour la période 2018-2021, soit 13 295 pages d’après le ministre. Ils se scindaient en deux blocs :
1/ la moitié relevait de l’évaluation des politiques publiques conduite par l’inspection générale
2/ l’autre moitié correspond à des inspections ciblant un service.
1/ En ce qui concerne les rapports élaborés dans le cadre de la mission d’évaluation des politiques publiques de l’inspection générale :
Le tribunal administratif avait considéré que les éventuelles mentions à occulter ne pouvaient être que limitées, eu égard à l’objet même des documents en cause ».
Le Conseil d’État valide ce raisonnement.
Dès lors que le tribunal a retenu que les occultations seraient limitées pour ce premier ensemble, il « n’était pas tenu, pour en déduire que la charge en résultant n’était pas disproportionnée, de prendre en compte l’intérêt que la communication pouvait représenter pour le syndicat requérant ainsi que, le cas échéant, pour le public ».
2/ En ce qui concerne les rapports correspondant aux documents relevant des catégories de « contrôle de fonctionnement », « inspection de fonctionnement », « suivi de contrôle de fonctionnement », « examen de situation », « inspection santé et sécurité au travail » :
Pour les rapports d’inspection ciblant une juridiction, un service ou une situation particulière, le Conseil d’État estime qu’ils sont, par nature, » tout particulièrement susceptibles de comporter des mentions dont les mêmes dispositions imposent l’occultation ».:
« Compte tenu de la gravité des atteintes qu’une divulgation est susceptible de porter aux secrets et intérêts protégés par ces mêmes dispositions, la sélection des passages à occulter aurait nécessairement appelé des vérifications approfondies, y compris pour éviter une divulgation indirecte. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les rapports relevant de ce second ensemble représentent environ la moitié des quatre-vingt-un rapports demandés, dont le ministre faisait valoir qu’ils comportaient au total près de 13 300 pages ».
➡️ En jugeant en l’espèce que le ministre n’établissait pas que la charge des occultations à effectuer sur les documents relevant de ce second ensemble était disproportionnée, compte tenu des moyens dont dispose l’inspection générale de la justice, le tribunal administratif a dénaturé les faits de l’espèce.
En définitive, le garde des sceaux n’obtient l’annulation du jugement que pour la partie relative au « second ensemble » de rapports.
Pour lire l’arrêt : CE, 10e–9e ch. réunies, 28 oct. 2025, n° 501248